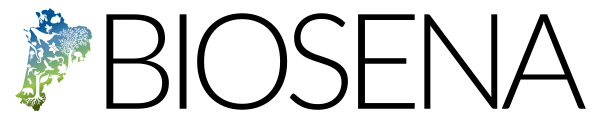Le réseau régional de recherche Biosena s’est associé aux écoles doctorales Entreprise, Économie, Société (université de Bordeaux), Euclide (La Rochelle Université), Montaigne Humanités (université Bordeaux Montaigne), au Centre des études doctorales de l’université de Pau et des pays de l’Adour et au Collège des écoles doctorales de l’université de Limoges afin de proposer une formation doctorale permettant de croiser les disciplines autour des sciences de la durabilité à destination des doctorant·es de toutes les universités de Nouvelle-Aquitaine.
Contexte
Les sciences de la durabilité (sustainability science) sont l’une des disciplines scientifiques à la plus forte croissance, attirant continuellement un grand nombre de jeunes chercheur·e. Pour réussir dans les sciences de la durabilité, les scientifiques doivent être doté·es de compétences à la fois dans les champs techniques, humains et sociétaux, et être à l’aise avec la pensée systémique et conditionnés à rechercher des collaborations interdisciplinaires.
Cet ensemble de compétences diverses et nuancées produit un nouveau profil de scientifique, indispensable pour aborder la durabilité au 21e siècle. Actuellement, ces compétences ne sont pas formellement intégrées dans la plupart des cursus, et leur apprentissage ne consiste pas simplement à intégrer davantage de matières dans des programmes déjà surchargés. Au contraire, des programmes spécifiques sont nécessaires pour former les étudiant·es à appliquer leurs compétences disciplinaires dans des cadres inter- et trans-disciplinaires.
La volonté est globale de créer des programmes diversifiés et inclusifs nécessaires pour former ces scientifiques, comme le prouvent l’initiative Future Leaders du Belmont Forum, le rapport Jouzel, les accomplissement de l’université virtuelle Environnement et développement durable ou les incitations du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au développement de troncs communs Éducation à l’Environnement et au Développement Durable dans les universités.
Objectifs
Adressée aux jeunes chercheur·es de toutes disciplines et de toutes les universités de la région, la formation doctorale L’Interdisciplinarité en Sciences de la Durabilité a pour ambition d’acculturer les chercheur·es à l’interdisciplinarité, à la pensée systémique, aux méthodes et enjeux des autres disciplines, à l’apport de leur propre discipline à des contextes variés et aux interactions sciences-société.
Par cette formation, l’ambition de Biosena, à l’échelle de la région, est d’encourager la recherche-action, de favoriser le dialogue territorial et l’appui aux politiques publiques, de promouvoir la recherche interdisciplinaire, et d’acculturer les futurs cadres et dirigeants aux problématiques environnementales impactant la société, quel que soit leur champ disciplinaire d’origine.
Cette formation théorique est complémentaire d’une formation pratique déjà en place depuis 2 ans, les Doctoriales de la Biodiversité, dans laquelle les doctorant·es se confrontent à des problématiques réelles issues du territoire.
Format
La formation L’Interdisciplinarité en Sciences de la Durabilité dure 14h, réparties en 7 sessions de 2h chacune, du 6 mai au 24 juin 2024, à raison d’un lundi par semaine, de 10h à 12h, à l’exception du 20 mai, férié. Les cours se font en distanciel sur la plate-forme Zoom afin de permettre la participation de doctorant·es de toute la région.
La formation est gratuite. Les intervenant·es étaient financé·es par les écoles doctorales et collèges d’écoles doctorale partenaires, sauf exception. La formation est réservée aux doctorant·es des universités de Nouvelle-Aquitaine.
Validation
Cette formation est sanctionnée par l’assiduité, c’est-à-dire qu’il était demandé aux participant·es d’assister à chacun des 7 cours afin de valider toute la formation. Une attestation est remise à chaque participant·e indiquant le nombre d’heures suivies de la formation (14h si assiduité intégrale), à l’attention de son école doctorale.
Attention, chaque école doctorale se réserve le droit de valider les heures comme elle l’entend.
Contenus
La formation est découpée en six chapitres disciplinaires menés par un·e enseignant·e-chercheur·e de la région, et précédés d’un préambule sous la forme d’une conférence sur les sciences de la durabilité.
Chaque chapitre est destiné à tous les doctorants, y compris ceux de la discipline concernée, qui peuvent ainsi questionner leurs pratiques au regard des enseignements et confronter leur expérience avec celle des autres doctorants. Les enjeux, outils et méthodes de chaque discipline sont présentés dans le contexte d’un travail de recherche interdisciplinaire de sciences de la durabilité.
L’objectif principal est l’apprentissage, via des exemples réels (témoignages, retours d’expérience), du fonctionnement de chaque discipline dans le cadre d’un projet interdisciplinaire de sciences de la durabilité. Les doctorants y apprennent comment cette discipline fonctionne par elle-même et en interaction avec les autres disciplines, avec quels outils, quelles méthodes, quelle temporalité, mais aussi quels sont ses objets de recherche et les contenus de ses publications, et comment mobiliser ses chercheurs dans un projet interdisciplinaire pour que chacun y trouve son compte et que la co-construction se fasse dès le départ dans les meilleures conditions.
Cet apprentissage s’accompagne nécessairement de la découverte de la réalité du travail de recherche dans les différentes disciplines (prisme de lecture, forces, faiblesses, biais, temporalité, outils) et favorise l’émergence d’un vocabulaire commun et d’un socle de compétences communes dans le travail interdisciplinaire.
Programme détaillé
Lundi 6 mai – Conférence Sciences de la Durabilité
Conférence de Sandrine Paillard, économiste de la science et de l’innovation et directrice du Future Earth Paris Hub. Après ses études post-doctorales sur les systèmes de recherche et d’innovation comparés, elle a rejoint un think tank gouvernemental français, le Commissariat général du plan, pour coordonner des études prospectives sur les relations science-société, impliquant des chercheurs et diverses parties prenantes. Elle a ensuite passé sept ans à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) en tant que directrice de l’unité prospective de l’institut. Elle y a encadré une série de projets visant à développer des scénarios dans le champ de l’agriculture, de l’environnement et de la sécurité alimentaire.
Lundi 13 mai – Philosophie
Cours donné par Cédric Brun, maître de conférences en philosophie à l’université Bordeaux Montaigne, laboratoire SPH. Cet enseignement vise à porter un regard épistémologique sur les travaux interdisciplinaires afin d’en identifier les promesses, les obstacles et les résultats, afin d’en tirer quelques leçons permettant de guider l’élaboration de projets interdisciplinaires. Il suit le plan suivant :
- Définitions de l’interdisciplinarité (qu’est-ce qu’une discipline, différences avec la multidisciplinarité et la transdisciplinarité),
- La demande institutionnelle et épistémologique d’interdisciplinarité : deux logiques différentes,
- Les réquisits du travail interdisciplinaire : une temporalité de travail spécifique, construire un langage commun, définir des problèmes d’investigation propres,
- Les limites institutionnelles et de structures à l’interdisciplinarité,
- Feuille de route pour un travail interdisciplinaire.
Lundi 27 mai – Géographie
Cours assuré par Marion Charbonneau, géographe de l’ancrage territorial de l’agroécologie, maîtresse de conférences à l’université de Pau et des pays de l’Adour, laboratoire TREE, et également membre du comité de pilotage et conseil scientifique de Biosena..
Cet enseignement vise à explorer les apports de regard du géographe dans l’étude des transitions environnementales. Pour ce faire, il présente les grands courants de la géographie qui s’intéressent aux questions environnementales et développe plusieurs exemples concrets de recherches menées par des géographes dans le cadre de projets interdisciplinaires. Chemin faisant, il interroge les enjeux des recherches en géographie qui s’intéressent aux transitions et de la pratique de l’interdisciplinarité.
À l’issue de ce chapitre, le doctorant sera capable :
- de comprendre et d’identifier certaines spécificités du regard du géographe qui favorisent le dialogue interdisciplinaire autour des sciences de la soutenabilité : analyse par l’espace et les territoires, multiscalaire, multi acteurs, etc. ;
- de saisir les approches géographiques de certaines notions mobilisées par d’autres disciplines dans la recherche sur la biodiversité et la soutenabilité des socio-écosystèmes : territoire, paysage, etc. ;
- d’identifier les principaux outils et méthodes que le géographe peut mobiliser pour explorer les transitions : cartographie, analyse qualitative, analyse quantitative, analyse de réseaux de politiques publiques, jeux d’acteurs, etc.
Lundi 03 juin – Économie
Cours assuré par Emmanuelle Augeraud-Véron, économiste de l’environnement, professeure à l’université de Bordeaux, laboratoire GRETHA.
L’objectif de cet enseignement est de présenter différentes approches interdisciplinaires de la durabilité. Nous insistons sur les enjeux spécifiques liés à la discipline, puis à travers différents exemples, nous montrons comment la prise en compte d’autres disciplines enrichit notre analyse, comme l’écologie (i.e. dynamique des différentes ressources et complexité des interactions, …), la sociologie (i.e. rôle des perceptions du risque et de l’incertitude, …), la science politique (théorie des jeux, négociation, …). Différents exemples sont présentés, de façon à intégrer différentes approches interdisciplinaires.
Lundi 10 juin – Droit
Cours assuré par Jessica Makowiak, juriste de l’environnement, professeure à l’université de Limoges, laboratoire CRIDEAU. Il aborde les sujets suivants :
- Qu’est-ce que la recherche en droit (en général) et en droit de l’environnement (en particulier) ? Objectifs et enjeux.
- Méthodologies : la recherche bibliographique (analyse de la doctrine), la recherche textuelle et jurisprudentielle, la place de la « pratique » (ou du terrain). La restitution des résultats (ouvrages, articles, rapports, études …). Pour quels acteurs ?
- Quel positionnement par rapport aux autres disciplines ? Une discipline a priori peu ouverte à la diversité (cloisonnements forts dans l’enseignement du droit lui-même).
- La spécificité du droit de l’environnement : une discipline nécessairement décloisonnée.
- Les objets de recherche : quel est le champ couvert par le droit de l’environnement (d’un point de vue substantiel, spatial, et temporel). Le « vocabulaire » du droit de l’environnement.
- La nécessité de l’interdisciplinarité. La dimension scientifique du droit de l’environnement (sciences dures). Le dialogue avec les autres sciences humaines (géographie, anthropologie, philosophie, économie, sociologie). Illustrations par des exemples de recherches interdisciplinaires. Obstacles, difficultés…
- L’exemple de l’évaluation environnementale : étude scientifique, instrument juridique, levier de la participation citoyenne.
Lundi 17 juin – Science Politique
Cours assuré par Alice Mazeaud, maîtresse de conférences en science politique à La Rochelle Université, laboratoire LIENSs.
Cet enseignement vise à explorer les différentes facettes des rapports entre politique(s) et environnement, et à envisager en quoi la science politique peut contribuer à l’analyse des processus de transition socio-écologique.
La science politique étant une « discipline carrefour », cet enseignement vise d’abord à explorer les enjeux et spécificités théoriques et méthodologiques de la discipline, ainsi que ses rapports avec les autres disciplines des sciences sociales (sociologie, économie, histoire, géographie).
Ensuite, à partir d’exemples concrets de recherche, il explore quelles peuvent être les contributions de cette discipline aux projets de recherche interdisciplinaires.
Lundi 24 juin – Écologie
Cours assuré par Julia Clause, écologue du sol, maîtresse de conférences à l’université de Poitiers, laboratoire EBI. Il aborde les sujets suivants :
- Qu’est-ce que la recherche en écologie (en général), quels sont les sous-domaines d’étude dont l’écologie appliquée, en lien avec les enjeux environnementaux actuels ? Objectifs et enjeux.
- Méthodologies : la nécessité d’un design et de protocoles expérimentaux (définitions, exemples), difficultés de leur mise en œuvre dans un contexte de recherche-action, et diversité des perceptions. La restitution des résultats (ouvrages, articles, rapports, études …). Pour quels acteurs ?
- Quel positionnement par rapport aux autres disciplines ? Une discipline en ouverture sur l’interdisciplinarité, nécessaire au regard des enjeux actuels, confrontée à la problématique des échelles d’études…
- L’exemple de l’évaluation environnementale : point de vue de l’écologue (concepts et outils mobilisés, craintes).
Chaque partie est illustrée d’exemples de recherches interdisciplinaires, avec des chercheurs ou des acteurs du territoire, et d’autres sujets peuvent être abordés.