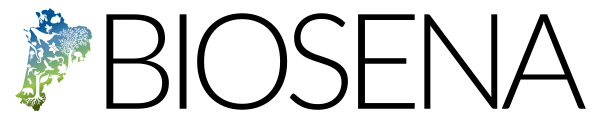Par ses multiples actions, Biosena rassemble et connecte les chercheur·es de la région par-delà les territoires, les institutions et les disciplines. Le réseau établit aussi des liens d’interconnaissance, de partenariat et de confiance entre recherche et acteurs du territoire. Ces connexions permettent la naissance de partenariats et projets de recherche et recherche-action finançables par les instances régionales et nationales.
Ce groupe de travail issu du comité de pilotage de Biosena a vocation à accélérer l’incubation de projets par trois modes d’action :
- en étant force de proposition auprès des chercheur·es de la région sur les appels à projets et appels à manifestation d’intérêt les plus prometteurs pour le contexte régional et les problématiques liées à la biodiversité et aux services écosystémiques,
- en identifiant les partenaires et membres potentiels de l’équipe projet (chercheurs ou acteurs du territoire) et en jouant le rôle de médiateur pour permettre leur rencontre,
- et en soutenant financièrement et logistiquement les phases de montage et de soumission des projets (planification de réunions, frais liés aux rencontres, etc)
AAP visés
Les appels à projets suivant ont été identifiés par Biosena comme des opportunités prioritaires en adéquation avec le réseau concernant leurs thématiques et leurs ambitions. Biosena souhaite donc faire naître et soutenir des projets pour y répondre.
ANR AAPG H1
 19/10/2023
19/10/2023

L’Appel à Projets Générique de l’Agence Nationale de la Recherche est structuré en 56 axes de recherche, dont le nouvel axe transversal H.1 Sciences de la durabilité.
La science de la durabilité s’intéresse aux interactions complexes entre les systèmes naturels et socio-économiques, et à la manière dont ces interactions affectent, dans le temps et l’espace, les systèmes de maintien de la vie sur la planète, et sa biodiversité, le développement socio- économique et le bien-être humain. Elle ambitionne d’apporter des éléments de réponses, fondées sur la science, aux grands défis sociétaux globaux et d’accompagner les grandes transitions de la société et les risques associés. Dans une approche intégrée, la science de la durabilité favorise – à différentes échelles de temps et d’espace – l’étude des fonctionnements, des dynamiques des éco- et anthropo-systèmes, leurs interactions à travers leurs multiples dimensions, qu’elles soient environnementales, écologiques, climatiques, physico-chimiques, ou bien encore culturelles, historiques, juridiques et socio-économiques. Elle permet de AAPG 2023 2.0 – 21 septembre 2022 55 décloisonner les recherches autour d’un objet commun et favorise notamment la prise en compte des interactions entre les 17 ODD.
De par la définition de la science de la durabilité, sont considérés comme relevant de cet axe des projets qui devront comporter les composantes suivantes:
- être centré(s) sur des transitions nécessitant une adaptation vis-à-vis de une ou plusieurs pression(s);
- présenter une inter- ou transdisciplinarité systématique. Lorsque cela est approprié, la problématique du projet de recherche pourra être co-construite avec des porteurs d’enjeux et faire l’objet d’un partenariat spécifique.
Mis en œuvre par l’équipe de chercheurs, le projet devra produire de nouvelles connaissances et conduire à la production d’outils d’aide à la décision et au déploiement de solutions durables, et répondre ainsi aux ODD. L’axe soutiendra des projets abordant au moins deux des trois volets suivants:
- analyse de situation (conflits d’usage et de gestion, tensions sur les ressources, antagonismes, risques entre autres liés aux aléas et évènements extrêmes, stratégies d’acteurs, cibles à atteindre, verrous à lever, finitude des ressources et impacts, etc.) ;
- solutions (remédiation, adaptation, atténuation, trajectoires vers la cible, solutions organisationnelles, systèmes d’alerte, etc.) ;
- modalités de déploiement (gouvernance, modèles socio-économiques, innovations technologiques et sociales, politiques publiques,etc.).
Les problématiques soutenues peuvent être de trois natures :
- centrées sur la science de la durabilité comme objet de recherche (concepts, approches et méthode) ;
- centrées sur la transformation comme objet de recherche ;
- construites autour de grands nexus (incluant biodiversité, climat, eau, ressources, énergie, alimentation, océan, santé, technologies, numérique, société) à différentes échelles de temps et d’espace (dont la ville, Pays du Sud comme du Nord, etc).
Ce nouvel axe reprend pour partie l’axe » Interactions humains – environnement » du plan d’action 2021. Les projets concernant l’évolution à très long terme de l’environnement et l’étude des paléoenvironnements sont attendus dans l’axe « Études du passé, patrimoines, cultures », y compris les aspects interdisciplinaires et/ou les aspects permettant d’éclairer les changements globaux en cours et à venir en lien avec l’action humaine.